Repenser le musée décolonial & Restitution du patrimoine africain : défis et réflexion
Le Musée McCord Stewart présente, en collaboration avec Nigra Iuventa, présente deux conversations dans le cadre du Symposium international RAN – Réseaux de l’Atlantique noir : patrimoines, savoirs et solidarités.
Repenser le musée décolonial
Depuis un certain nombre d’années, les institutions muséales sont appelées, par leurs publics et leurs parties prenantes, à repenser leurs modes de fonctionnement à la lumière des biais occidentaux et coloniaux des musées. Cette table ronde s’intéresse aux changements qui en ont découlé et à leurs retombées.
Qu’est-ce qu’une approche décoloniale implique pour la monstrabilité des collections, autant que pour leur conservation et leur restitution ? Quelles formes de savoir et de savoir-faire sont mises en avant au musée, et comment ? À quoi ressemblent les collaborations dites décoloniales, et permettent-elles des transformations structurelles profondes ? Les musées réussissent-ils à développer des stratégies adaptées à leurs contextes culturels et historiques spécifiques ? Comment comprendre le rôle des nouvelles initiatives muséales dans la géopolitique contemporaine ?
En s’appuyant sur leur expérience pratique dans divers projets muséaux — en tant qu’artistes, curateur·rices, chercheur·es et médiateur·rices — Moridja Kitenge Banza, Léuli Eshragi et Michèle Magema proposeront des pistes de réflexion et de débat autour de ces questions.
Panélistes :
Michèle Magema
Moridja Kitenge Banza
Léuli Eshrāghi
Modératrice:
Abigail E. Celis (elle)
suivi de Restitution du patrimoine africain : défis et réflexion
Le discours du président Emmanuel Macron en 2017 à l’université de Ouagadougou a été le point déclencheur, en France, d’un profond changement d’appréhension de certains pans des collections publiques conservées à travers le pays. Cette prise de conscience — lente ou rapide, volontaire ou contrainte — se matérialise ces derniers mois par de nombreuses initiatives et dispositifs nouveaux mis en place.
Cette rencontre propose un état des lieux des avancées d’abord politiques, puis juridiques et professionnelles, traduisant de véritables renversements éthiques, longtemps attendus par les pays anciennement colonisés par la France. Seront présentés plusieurs exemples de projets menés dans un contexte muséal français, en partenariat avec des institutions africaines, touchant au partage des inventaires, à l’étude croisée des collections conservées en France, ainsi qu’aux enjeux de retours de patrimoine sur le continent africain.
Conférence d’Émilie Salaberry (Musée d’Angoulême) suivie d’un échange avec Daphnée Yiannaki (Université du Québec à Montréal)
Informations pratiques
Activité gratuite en français, présentée le jeudi 20 novembre 2025, de 18 h à 19 h 45.
Places limitées, réservation requise.
Durée : 1 h 45 minutes
Lieu : Atrium du Musée McCord Stewart
Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite
À propos des panélistes
Michèle Magema
Michèle Magema, née en République démocratique du Congo en 1977, est une artiste visuelle franco-congolaise. Sa pratique interdisciplinaire — vidéo, performance, photographie, dessin et installation — interroge les récits et la mémoire des histoires coloniales, les transmissions orales et les féminismes intersectionnels et décoloniaux. Lauréate du premier prix de la Biennale de Dakar (2004), elle a exposé à l’international (Brooklyn Museum, NY – Centre Pompidou, FR – Hayward Gallery, GB – Mori Art Museum, JP – Bozar, BE) et ses œuvres figurent dans des collections majeures (AfricaMuseum, BE – Musée Rietberg, CH – Fondation Sindika Dokolo, AN – FRAC Réunion, FR). Cofondatrice de l’espace USANII, elle est aussi commissaire d'exposition et enseignante. Professeure invitée à l’UQAM en 2023-2023, elle y poursuit un doctorat en création.
Photo © UQAM- Émilie Tournevache
Léuli Eshrāghi (Conservateurice des pratiques autochtones, Musée des beaux-arts de Montréal)
Léuli Eshrāghi appartient aux clans sāmoans Seumanutafa et Tautua et à la diaspora persane, et vit et travaille à Montréal, Québec, Canada. Sa démarche privilégie l’art et le design, les langues sensuelles et parlées, et les pratiques cérémonielles-politiques autochtones, noirs et asiatiques.
Photo © Rhett Hammerton
Moridja Kitenge Banza
Moridja Kitenge Banza, né à Kinshasa en 1980, est un artiste canadien d’origine congolaise. Diplômé à Kinshasa, Nantes et La Rochelle, il reçoit le 1er prix Dak’Art 2010 pour Hymne à nous et De 1848 à nos jours, puis le Prix Sobey 2020. Son œuvre explore mémoire, histoire et territoires.
Photo © Moridja Kitenge Banza
Abigail E. Celis (Université de Montréal)
Abigail E. Celis is an assistant professor in Art History and Museum Studies at the Université de Montréal (Tiohtià:ke). Her research focuses on the afterlives of colonialism and decolonial imaginaries as witnessed through contemporary visual culture, artistic creation, and museum practice.
Photo © T. Heller
Emilie Salaberry (Musée d'Angoulême)
Diplômée en histoire de l’art (École du Louvre et Université Panthéon-Sorbonne, spécialisée en arts africains), elle a exercé au Centre du Patrimoine mondial de l'UNESCO (Unité Afrique) puis comme chargée des collections extra-européennes au Musée d'Angoulême. Aujourd’hui directrice du service des musées, archives et artothèque d’Angoulême, elle mène ses missions de conservateur dans un cadre collaboratif international, notamment avec plusieurs pays africains. Elle s’est investie dans la recherche sur l’histoire des collections extra-occidentales, leurs provenances et les enjeux de restitutions du patrimoine.
Photo © Musée d'Angoulême
Daphnée Yiannaki (Université du Québec à Montréal)
Daphnée Yiannaki, muséologue et historienne de l’art allochtone, poursuit un doctorat en muséologie, médiation, patrimoine, sur les processus d’autochtonisation et de décolonisation des musées d’art. Récipiendaire d’une bourse du FRQSC, elle est, entre autres, secrétaire des Cahiers du CIÉRA et assistante de recherche pour le Partenariat CIÉCO.
Photo © Sarah Cousineau
En collaboration avec








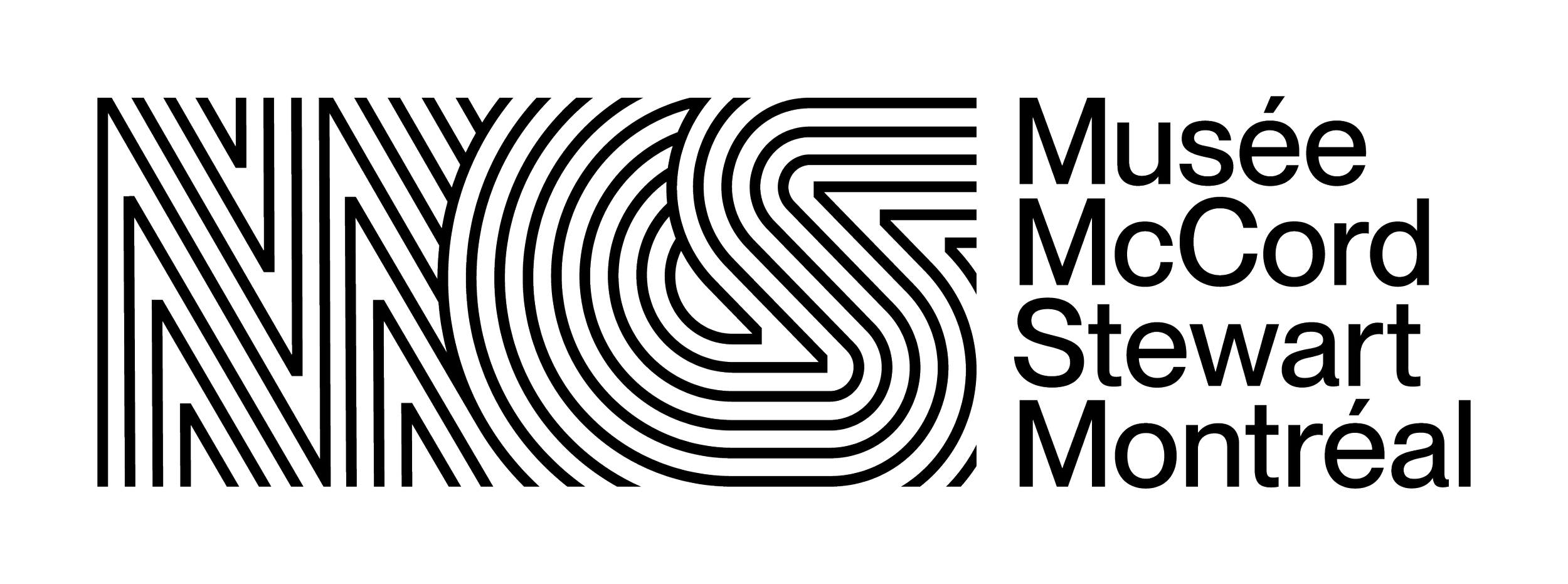
![Musee-Angouleme-[baseline] - Emilie Salaberrry.png](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/636ac708b80b8e5c60e471ce/111907ed-0a09-44b7-afe1-a83263dbf7aa/Musee-Angouleme-%5Bbaseline%5D+-+Emilie+Salaberrry.png)